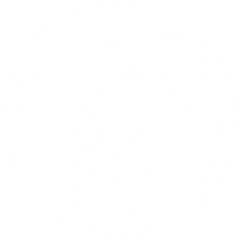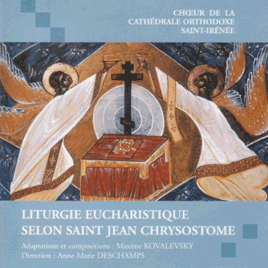| 01 | Grande Litanie |
| 02 | 1er Antiphone |
| 03 | 2ème Antiphone : Hymne à l’empereur Justinien |
| 04 | 2ème petite litanie |
| 05 | Petite entrée (3ème antiphone) – Les béatitudes |
| 06 | Chant d’entrée |
| 07 | Tropaire de demande |
| 08 | Chant à la Vierge (1er ton orné) : Tropaire de la fête de la Sainte Rencontre |
| 09 | Trisagion |
| 10 | Prokimenon (Graduel) |
| 11 | Epitre – Alleluia |
| 12 | Evangile |
| 13 | Litanie après Evangile |
| 14 | Grande Entrée : Hymne de Chérubin |
| 15 | Litanie de supplication |
| 16 | Baiser de paix |
| 17 | Credo (de Nicée) |
| 18 | Canon eucharistique |
| 19 | Sanctus |
| 20 | Chant pendant l’épiclèse |
| 21 | Hymne à la Vierge |
| 22 | Préparation à la Communion (Litanie) |
| 23 | Notre père – Communion des fidèles |
| 24 | Trisagion : Chants et prières d’actions de grâce |
| 25 | Trisagion : Chants et prières d’actions de grâce |
| 26 | Clôture |
Lecture du Livre du prophète Ezéchiel (par Monseigneur Jean, Evêque de St Denis)
Ce disque offre, en français, le déroulement de la Liturgie eucharistique du rite byzantin, la Liturgie selon Saint Jean Chrysostome. Encore récemment cette liturgie n’était connue que dans les langues appartenant au christianisme dit oriental, c’est-à-dire surtout en grec patristique, en slavon, en roumain.
Un peu partout dans notre monde « en recherche » s’éveille un intérêt grandissant pour la piété liturgique de l’Eglise orthodoxe à travers ses icônes, ses ouvrages de spiritualité et ses chants, autant d’éléments qui touchent la sensibilité et ne sont recherchés souvent que pour leur contenu émotionnel. Or en ce qui concerne les chants de l’Eglise orthodoxe, du fait qu’ils ne sont généralement connus en Occident qu’à travers une langue ignorée de la plupart, ils n’atteignent pas pleinement le but essentiel que leur assigne l’Eglise : véhiculer les textes sacrés pour les rendre assimilables non seulement par l’émotion artistique mais aussi par l’intelligence.
Dans sa sagesse, l’Eglise orthodoxe prescrit de célébrer l’Office divin en langue compréhensible, ce qui a toujours été fait dans les pays où se rencontrent des fidèles orthodoxes en nombre suffisant – comme dès le début dans les pays du Moyen-Orient – qu’il s’agisse d’orthodoxes par immigration ou par conviction. C’est ainsi que sont peu à peu apparues des célébrations en roumain, en arabe, en finnois, en japonais. Dans ces pays où la foi orthodoxe avait été introduite plus ou moins tardivement, les textes étaient traduits dans la langue du pays dès qu’il apparaissait que le grec patristique ou le slavon qui les avait transmis était devenu incompréhensibles par le peuple. Il en est de même aujourd’hui en raison du brassage des populations consécutif aux guerres et aux révolutions : des groupes ethniques émigrés voient leurs jeunes générations, soucieuses néanmoins de demeurer fidèles à leur tradition religieuse, ne plus guère comprendre, dans la plupart des cas, la langue liturgique de leurs ancêtres.
Le même problème existe pour ceux qui, un peu partout, ont choisi de devenir membres de l’Eglise orthodoxe, non seulement par impulsion émotionnelle ou artistique, mais par réflexion théologique. Il se pose dans tous les pays d’Occident et en particulier en France, où nous voyons se développer des communautés d’orthodoxes français pour qui les célébrations s’imposent en français.
Les textes liturgiques ont donc été traduits et l’on voit coexister deux méthodes d’élaboration des chants dans cette langue, nouvelle pour le rite byzantin. L’une utilise tels quels des chants déjà existants, généralement composés après le 18e siècle, « forçant » les traductions dans les limites de moules musicaux tout faits, devenus pour ainsi dire « sacrés ». L’autre méthode recrée à nouveau des chants adaptés aux nouvelles traductions, tout en respectant les principes premiers de composition qui ont jadis donné communément naissance à tous les chants chrétiens (devenus différents cependant dès l’origine en raison des différences de rythme et d’intonation des langues qui les supportaient). C’est cette technique de recréation, basée sur le respect des principes de composition des mélodies monastiques primitives, qui a presque constamment été utilisée pour la composition de cette liturgie en français. Dans ce même esprit, tout en respectant la ligne mélodique et l’harmonie de certaines œuvres des compositeurs liturgistes slaves des siècles derniers considérées comme traditionnelles, leur traduction a donné lieu à une adaptation musicale fidèle bien que souple.
Si son caractère musical évoque le pays d’origine de son auteur (les sonorités sont «russes»), c’est parce que ce dernier en a élaboré les chants à partir des 8 tons ecclésiastiques slaves, comme il aurait utilisé les 8 tons grecs s’il avait été formé dans la tradition grecque. Pour la composition d’une liturgie de rite occidental, c’est à partir des 8 tons grégoriens liés au latin d’où est issue la langue française qu’il a élaboré en français la plupart des chants de l’année liturgique.