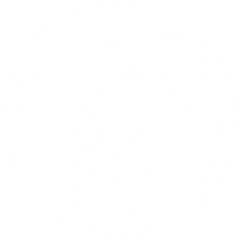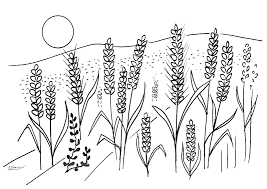Dimanche 9 février 2025.
Homélie du père Bernard Jakobiak
4ème dimanche après la Théophanie.
L’ivraie et le bon grain.
Paroisse de la Théophanie, 34000 Montpellier
Église catholique Orthodoxe de France.
Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit,
Filles et filles de Dieu,
Le prophète nous invite aujourd’hui à entendre l’histoire de l’humanité, et même de la création visible jusqu’à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que ni les anges ni les hommes ne pourront éradiquer l’ivraie avant le retour du Christ en gloire. Et de même qu’il y aura toujours des pauvres parmi vous, comme l’a souligné Jésus à ses disciples, il y aura toujours des méchants, des violents, des menteurs, des gens, des agitateurs, des calomniateurs, des fauteurs de guerre, et cetera. Dieu n’intervient pas pour détruire ces hommes-là afin de ne rien endommager du bien qui est sa création. Dieu laisse à la création son autonomie. Il ne lui impose pas sa volonté. Ce n’est pas un tyran et ce n’est pas non plus, un juge renfrogné qui va assommer les pêcheurs les uns après les autres. Il ne veut pas imposer sa volonté. Il la propose comme on propose l’amour à qui l’on aime. Et Dieu aime la race humaine et toute la création visible, sensible et plus ou moins invisible.
Dieu n’a pas créé le mal ; le mal n’a pas d’être. Il est seulement le fruit d’une volonté pervertie, un ange déchu comme il y en a. Lucifer, par exemple, devenu jaloux de l’homme dont il a vu le prodigieux destin est jaloux parce que lui, ne possède pas ce que l’homme possède, qui est la chair. L’ennemi et les ennemis de toute sa bande agissent à partir de diverses formes de ces volontés perverties. Et cette volonté de l’ennemi est de détruire la vie, de la faire détruire, parce qu’il serait bon pour toutes ces perversions d’anéantir la race humaine qui fait l’outrage à ceux qui sont pur-esprits de mettre au-dessus d’eux quelqu’un qui est moins pur à ses yeux de démon, qui est l’homme.
Si Dieu a créé une volonté qui peut s’opposer à Lui, c’est aussi qu’Il ne se réduit pas à sa toute-puissance. Il ne saurait baser sa création sur la loi du plus fort, comme a tendance à le faire l’homme s’il reste myope, et s’Il donne son autonomie à la créature, c’est que dans la liberté seule, elle devient capable de répondre à son amour. On ne devient pas amoureux sans cette liberté de l’être. C’est ainsi que l’homme est appelé à devenir amoureux de Dieu, roi et prêtre de la création tout-entière dans l’amour, l’amour qu’on pourrait dire alors divino-humain. La nature humaine libérée par le Christ de l’emprise de toutes les volontés perverties dont elle s’était fait l’esclave et proposer à l’humanité, à chacun et à chaque nation, de L’accepter ou de Le refuser. L’ivraie est ce refus, la chute dans les illusions et les prétentions des créatures qui oublient Dieu, ou se révoltent contre Lui, ou font tout pour Le nier. Et l’histoire tragique de la création persiste.
L’Église propose à ce sujet l’enseignement de l’apôtre Paul que nous connaissons : il s’agit de rester fidèle quelles que soient les épreuves ; au fond, de les laisser passer comme le peuple élu a traversé la mer Rouge. Comment faire ? Le conseil est simple : quoi que vous fassiez, faites-le consciemment au nom de Jésus-Christ. Que se passe-t’il alors ? Ce n’est plus l’œuvre qui compte, même la meilleure ; ni l’ennui d’avoir affaire toujours à la même corvée ; l’esprit devient libre. Quelle que soit l’épreuve, quel que soit le devoir à faire, l’homme s’ouvre alors à la victoire du Royaume de Dieu. Et l’épreuve acceptée aboutit à une naissance à un autre niveau de la vie humaine ; à une orientation vers la déification. Dans ce sens, on peut comparer celui ou celle, c’est ce que fait l’Évangile, à une femme enceinte : elle va souffrir, mais une fois qu’elle a mis au monde le neuf, quelqu’un de neuf et d’irremplaçable, elle oublie tout ce qu’elle a souffert. C’est notre nature qui nous invite à cela. L’apôtre Paul enseigne que l’esprit de l’homme – s’il le laisse s’exprimer, est comme un océan de calme, de mise au large et il peut, cet esprit si son esprit se nourrit de la parole de Dieu, la seule nourriture qui lui convienne ; sinon il est famélique spirituellement et il lui est permis, même s’il a 80 ou 100 ans, de grandir encore, si Dieu le maintient dans cette parenthèse qu’est notre pèlerinage sur cette terre. Cette croissance, me semble-t-il, c’est peut-être une opinion seulement, n’aura pas de fin : elle oriente vers l’amour de Dieu dont l’intimité n’en finira pas de le combler. Et c’est cette plénitude qui est le sens même de la vie à quoi nous sommes invités. C’est le sens de l’histoire. Elle n’est pas dans la lutte des classes, elle n’est pas dans la loi du plus fort. Elle est là. Elle n’est pas un chemin de facilité ni une installation définitive. Par exemple dans le cantique des Cantiques, la bien-aimée de Dieu dit : « je dors mais mon cœur veille ». Et le texte remet les choses à leur vraie place. La suite montre que c’est une tentation et rien qu’une tentation. Si je me dis « je suis arrivé, ça y est, je peux dormir tranquille », alors la présence du bien-aimé Dieu est perdue. L’amour de Dieu devient un souvenir et on le garde comme un fossile, comme un objet dans sa poche. Croire à « je dors mais mon cœur veille » est à voir comme un sentimentalisme dangereux.
Ce qui compte, c’est l’esprit qui a la possibilité de veiller alors que le cœur voudrait se contenter d’avoir aimé Dieu. Il se situe dans un passé qu’il idéalise et non pas dans le présent qui sera qui peut être une façon d’être comblé, ni dans le futur de la destinée de chacun.
L’histoire humaine a un sens. Elle n’est pas un rien entre deux néants : celui d’avant la naissance et celui d’après. La personne révélée à elle-même bénéficie de la lumière de l’Esprit-Saint autant qu’elle peut la recevoir. La personne n’est pas l’individu, au contraire. La personne est tournée vers Dieu et vers les autres, dans l’amour. « Je fais ce que je veux » est une illusion. La personne est aussi la communauté humaine, la nation si la nation est vraiment baptisée. Y a-t-il des nations baptisées ? C’est une autre question. Et dans la foi retrouvée, il est demandé – le Christ nous demande – « Allez enseigner les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C’est dans ce sens qu’il est bon de voir, même dans les gouvernants, quels qu’ils soient, même médiocres, les serviteurs de Dieu. S’ils sont mauvais, d’une part, ils sont le fruit de l’histoire du groupe, et d’autre part une mémoire ; ils deviennent l’épreuve qui révèle les illusions et les erreurs communes. Il s’agit de voir en face.
Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu Un, nous donne la grâce de désirer cette lucidité dans la patience, dans l’humilité vraie, dans la confiance et le goût de la liberté retrouvée, dans un début de plénitude qui va vers le Royaume. Que ce chemin soit le nôtre.
Amen.
+ Bernard Jakobiak